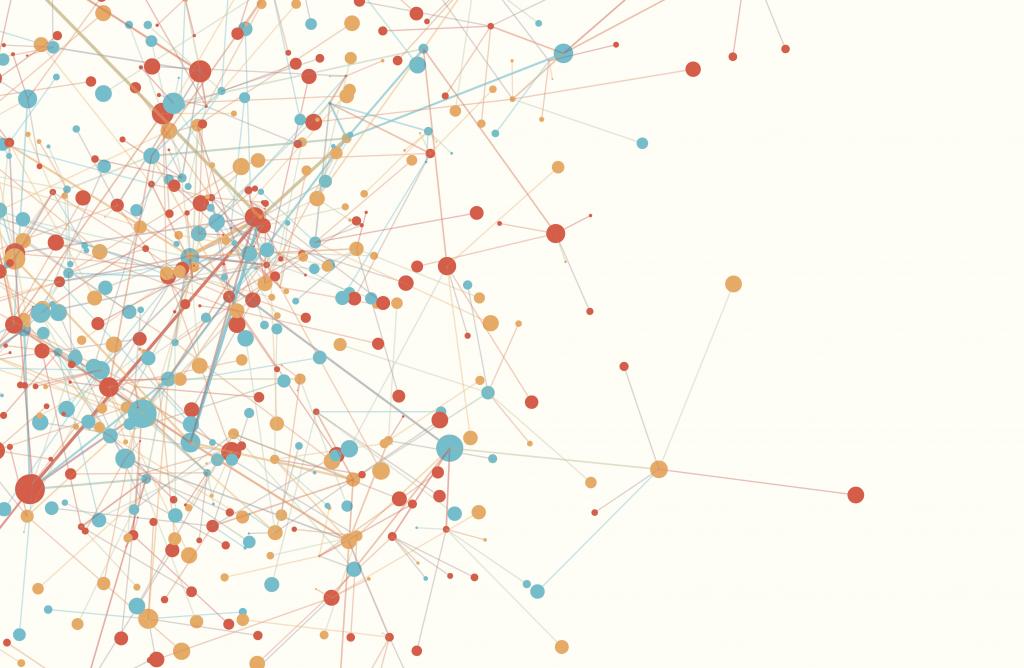Nommé professeur d’économie à l’Institut de hautes études internationales en 1969, il en a été le directeur de 1990 à 1998. Ses intérêts portent sur la coordination des politiques macroéconomiques, la stabilité et la réglementation financières internationales, le rôle des institutions financières internationales, l’évolution de la technologie financière et ses implications politiques. Entretien avec le professeur honoraire Alexandre Swoboda.
Vous avez présenté vos recherches récentes sur le bitcoin à l’occasion d’un Briefing Lunch de l’Institut. Pourquoi cet intérêt pour les monnaies virtuelles?
Cela peut sembler bizarre pour un économiste comme moi qui s’est toujours intéressé aux questions macroéconomiques, mais ce travail est en quelque sorte un retour aux origines. Il se trouve que, jeune étudiant en doctorat, j’ai commencé à travailler sur un sujet assez classique, dont les données se sont avérées rapidement insuffisantes pour une utilisation économétrique pertinente. C’est mon directeur de thèse, James Tobin à Yale, qui m’a alors parlé d’une nouvelle forme de monnaie bancaire appelée l’«eurodollar», et c’est ainsi que j’ai écrit ma thèse puis l’un des premiers, sinon le premier article scientifique traitant du sujet d’un point de vue théorique. Il y a environ trois ans, à la suite d’une question de mon épouse sur le bitcoin, j’ai commencé à m’intéresser au sujet. Ma première question a été de savoir pourquoi on appelait cela une monnaie. J’ai vite conclu que le bitcoin n’est pas une monnaie car il ne remplit de manière adéquate aucune des conditions habituellement requises pour mériter ce titre. Pourtant, le bitcoin et autres cryptomonnaies sont très à la mode, même si la flambée de leur prix représente, à mes yeux, une bulle et qu’il règne beaucoup de confusion dans l’esprit des gens. La première présentation que j’ai faite à ce propos, c’était en Chine, il y a un peu plus de deux ans. À l’époque, je me demandais comment le système pouvait ne pas s’effondrer. Or, c’est reparti encore plus fort après. Toutefois, je ne conseille ni ne déconseille d’acheter des bitcoins. Pour moi, pour ce qui est de garantir des gains, cela revient à jouer au casino.
Sur quoi travaillez-vous actuellement?
Je continue à travailler sur l’impact de la «fintech» que j’avais abordé dans le cadre d’un séjour récent au Fonds monétaire international. J’essaie d’analyser les conséquences des cryptomonnaies pour les banques centrales. Comment ces banques vont-elles réagir? Devraient-elles émettre des cryptomonnaies ou des monnaies digitales sous une forme différente? Il est nécessaire de bien comprendre ce qui se passe et d’en saisir toutes les implications, par exemple pour la régulation par les banques centrales ou leur rôle par rapport aux banques traditionnelles et aux nouveaux acteurs dans le système financier, à la fois national et international.
Parmi vos lectures récentes, lesquelles vous semblent-elles importantes pour votre domaine de recherche ou votre discipline?
Le capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, que j‘ai parcouru plutôt que lu. Cet ouvrage est certes controversé tant pour ses conclusions que pour le modèle de croissance qu’il utilise, mais il a suscité un débat important dans ma discipline en mettant sur le devant de la scène la question de la distribution des richesses et du revenu. Cette question restera au centre des préoccupations tant de l’analyse que de la politique économiques ces prochaines années.
Le monde de demain verra-t-il une meilleure répartition des richesses?
Pour ma part, je ne crois pas à une solution facile. Des crises politiques et sociales vont très certainement jalonner la route menant à une meilleure (encore faut-il s’entendre sur ce «meilleure») répartition des richesses. L’aspiration élémentaire à monter dans l’échelle sociale semble aujourd’hui bloquée. C’est un problème de nature politique et sociale, et j’espère que sa résolution pourra se faire sans une révolution.
Quels sont les travaux académiques classiques que selon vous chacun devrait lire?
Aux étudiants en économie je conseillerais des classiques, en commençant par Adam Smith, notamment pour la partie philosophique, qui malheureusement ne nous intéresse plus beaucoup aujourd’hui, et sa réflexion sur le monde économique qui est d’une richesse incroyable. Je conseillerais aussi le Value and Capital (1939) de John Hicks.
Dans mon domaine plus précis, je recommanderais Robert Mundell qui m’a beaucoup appris, sans compter que c’est un mentor et un ami. Son livre intitulé International Economics (1968) est d’une richesse et d’une élégance de pensée remarquables. Ses raisonnements théoriques simples et clairs sont cependant parfaitement applicables aux questions de l’économie réelle contemporaine.
Comment voyez-vous l’évolution de la recherche académique au cours des quarante dernières années?
La recherche et la connaissance sont devenues de plus en plus pointues. Des travaux extraordinaires et extrêmement prometteurs ont pu être menés grâce notamment aux applications économétriques et aux big data. On en avait déjà vu des prémices avec des penseurs comme Gary Becker qui ont tenté d’appliquer la théorie microéconomique à toutes sortes de domaines.
En même temps, on observe un morcellement des travaux sous la pression du nombre croissant d’économistes et de domaines de spécialisation. Sans compter que certains facteurs contribuent à scléroser la pensée. Les meilleures universités forment des étudiants qui, une fois professeurs, enseigneront à leur tour à de futurs docteurs selon les mêmes modèles de pensée. De ce fait, le système tend à se perpétuer et à se rigidifier. Ce phénomène est encore aggravé par les méthodes de promotion des professeurs et des chercheurs, fondées sur un système de reconnaissance par les publications qui ne facilite pas l’originalité et qui repose sur une logique de mode. Par exemple, pendant une quinzaine d’années on ne pouvait pas publier un article de macroéconomie sans utiliser un modèle «DSGE» («équilibre général dynamique stochastique»). Aux mains des meilleurs, c’est un bel outil. Aux mains des autres, c’est loin d’être le cas. Son usage imposé a empêché le développement ou le retour à des questions plus simples pour estimer par exemple des comportements microéconomiques à l’aide d’une économétrie traditionnelle. Cela dit, faire dépendre la promotion des professeurs de leurs publications et leurs recherches est un énorme progrès par rapport au modèle, trop souvent pratiqué en Europe jusqu’à récemment, de la promotion incestueuse des assistants fidèles, mais pas nécessairement les plus doués, par leurs professeurs. Et l’on constate également un agréable retour à des questions traditionnelles et plus générales, notamment dans le domaine macroéconomique, ce qui montre que la situation est en train de se décanter.
Comment redonner la liberté de penser de manière originale?
Les gens ont la liberté de penser. Elle pourrait être favorisée, comme cela est en train de se passer dans les meilleures universités, par le recours à une meilleure interdisciplinarité – mais pas le type d’interdisciplinarité qu’on essaie toujours de nous vendre. Non, la vraie, celle qui répond à un besoin, pas celle que l’on impose. Par exemple, mon domaine développe des travaux applicables à d’autres sciences sociales et s’inspire de leurs travaux. Entre un politologue et un économiste, il peut y avoir un dialogue fructueux quand les protagonistes ne sont pas avant tout des journalistes qui cherchent la gloire, mais des chercheurs dont les réflexions communes vont se nourrir mutuellement. Des Prix Nobel récents comme Daniel Kahneman ouvrent certains aspects de la discipline à d’autres disciplines. Il faut aussi réfléchir à l’internet, aux conséquences du web sur l’emploi, à la gestion des villes par des systèmes informatiques. On retrouve dans beaucoup de ces domaines des réponses issues de méthodes développées pour résoudre d’autres questions économiques.
Quels livres (académiques ou non) lisez-vous actuellement?
Je suis en train de terminer Moonwalking with Einstein, de Joshua Foer. Il porte sur la mémoire et les processus de mémorisation. Du coup, il vous fait réfléchir à l’apport de l’écriture, d’abord, de l’impression, ensuite, et enfin de la digitalisation sur le rôle de la mémoire et son externalisation, sur notre façon de penser et de percevoir le monde. La transmission d’une génération à l’autre suppose que l’on gagne et que l’on perde des choses. Pour la petite histoire, le livre a été écrit par un journaliste qui s’est intéressé aux concours de mémorisation aux États-Unis. Fait incroyable, il est devenu lui-même un champion en l’espace d’une année.
L’autre livre que je lis s’intitule The Business Blockchain car j’essaie de comprendre ce qui est effet de mode et ce qui ne l’est pas dans l’engouement pour les nouvelles technologies financières. Dans le contexte actuel, il y a un bouquin à faire relire par tous sur les bulles spéculatives: Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds de Charles Mackay, publié pour la première fois en 1841.
* * * * *
Interview par Marc Galvin, Bureau de la recherche.